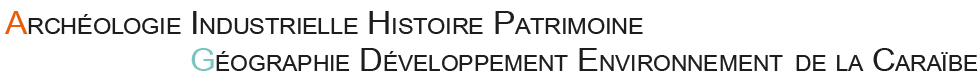En Haïti, la question migratoire constitue un nœud structurel pour approcher et comprendre les réalités de cette société. Depuis la première occupation du pays par les États-Unis, en 1915, la vie nationale est rythmée par des déplacements massifs des Haïtiennes et des Haïtiens, qui le construisent en tant que pays d’émigration (Paul, 2020). De 1915 aux années post-2010, marquées par le séisme du 12 janvier, le pays a connu au moins six grandes vagues migratoires (...) Partant de ces considérations comme de puissants facteurs d’expulsion, il y a là une invitation au bilan d’un siècle et plus d’émigration haïtienne. Dans cette visée, Terra incognita haitiana peut être une bonne base pour questionner autant la dimension positive de cette migration, que sa dimension négative, dont la « désaccumulation du siècle » : la décapitalisation en termes de fuites de cerveaux qui aurait pu être profitable à la société haïtienne. Aussi, faut-il soutenir à la suite d’Anglade (Ibid.) que cette grande « désaccumulation » du siècle ait aussi son aspect positif ? Ou encore, comment comprendre les répercussions politiques, économiques, sociales et culturelles de l’émigration en Haïti sur les plans macro, méso et micro ? Aussi ce dossier thématique encourage les contributions qui abordent le champ en tenant compte à la fois des discours construits autour du fait sur les terrains tout en questionnant les cadres conceptuels et théoriques abordant ces migrations. In fine, le dossier accueillera des contributions issues de différentes disciplines, se déployant sur des terrains géographiques divers et recourant à des armatures conceptuelles différentes. Les éditeurs porteront aussi une attention à la description des méthodes et des contextes d’enquête qui seront amenés dans le présent numéro.